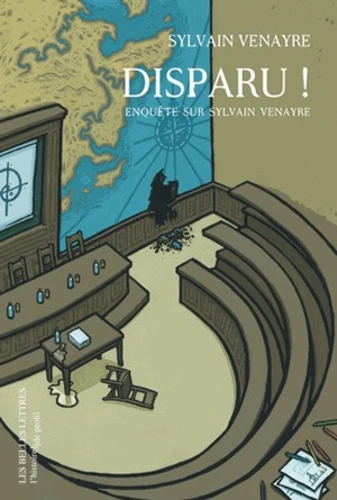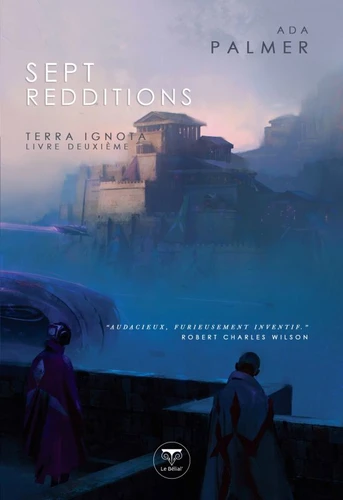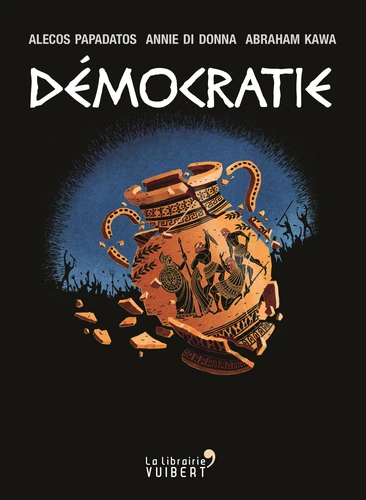« Aucun artiste, aucun écrivain, aucun homme ne mérite d’être consacré de son vivant, parce qu’il a le pouvoir et la liberté de tout changer. Le Prix Nobel m’aurait élevé sur un piédestal alors que je n’avais pas fini d’accomplir des choses, de prendre ma liberté et d’agir, de m’engager.»
J.P. Sartre
En 1951, Julien Gracq refusa le prix Goncourt pour Le rivage des Syrtes, alors que Sartre boudait systématiquement toute distinction (y compris le Nobel de Littérature en 1964). Mais il faut bien avouer qu’en dehors de ces quelques coups d’éclat, les auteurs ont plutôt tendance à apprécier les distinctions et c’est tout à fait compréhensible, personne ne songerait à leur jeter la pierre. Les auteurs doivent vivre de leur plume et certains prix sont, sinon richement dotés (Nobel), au moins synonymes de tirages très importants (Goncourt). Ils sont par ailleurs l’expression d’une certaine forme de reconnaissance. Oui mais voilà, avouons tout de même que c’est un peu toujours les mêmes têtes que l’on voit et que les primés manquent quelque peu de diversité.
Il faut croire d’ailleurs, que la postérité n’est pas beaucoup plus tendre que votre serviteur avec les prix. Qui se souvient en effet des nombreux livres distingués depuis plus d’un siècle par le Goncourt ? Qui même se souvient d’une majorité des auteurs récompensés ? Je confesse ici un peu de mauvaise foi, mais ce qui m’agace c’est le fait que ces prix drainent l’attention des médias, des critiques et en grande partie des lecteurs, au détriment d’autres œuvres de qualité. Cette focalisation outrancière est délétère et toxique pour le monde du livre, elle est l’arbre qui cache une magnifique forêt, qui ne demande qu’à être explorée. Rappelons qu’en France, un tirage moyen tourne autour des 2000 exemplaires, alors qu’un Goncourt est l’assurance de faire un tirage à 100 000 exemplaires, un rapport de force qui nous rappelle, hélas, que la littérature est aussi et surtout un marché aux consonances purement capitalistiques. Les gros ramassent gros et les petits n’ont guère que leurs yeux pour pleurer.
Faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain ? Certes, non, ce serait à la fois stupide et injuste, d’autant plus qu’en ce qui concerne Olga Tokarczuk, je n’ai jamais eu le plaisir de lire de littérature polonaise (ou alors ma mémoire me joue des tours) et la personne qui m’a remis ce roman est une amie dont je respecte éminemment les goûts littéraires. Bref, deux bonnes raisons pour se lancer dans la lecture de Sur les ossements des morts.
Très honnêtement, je ne savais pas grand chose d’Olga Tokarczuk avant de débuter ce roman, si ce n’est qu’elle avait obtenu le prix Nobel de Littérature en 2018…. à la place de d’Haruki Murakami, éternel favori, toujours recalé depuis quinze ans. C’est donc vierge de tout à-priori que j’ai commencé cette lecture, mais ne vous attendez pas à ce que je me prononce concernant le bien-fondé de l’attribution de son prix Nobel, je laisse cette épineuse question aux spécialistes.
Direction donc le sud-ouest de la Pologne, non loin de Wroclaw. C’est dans un petit hameau perché sur un plateau isolé, à quelques encablures de la frontière tchéque, que Janina Doucheyko a choisi de prendre sa retraite. Ancienne ingénieure, puis enseignante, Mme Doucheyko, n’aime pas trop qu’on l’appelle par son prénom et encore moins que l’on écorche son nom. Il faut dire qu’elle a un caractère bien trempé et ne s’en laisse pas compter. Sur le plateau les hivers sont rudes et il faut du courage pour y résider à l’année. D’ailleurs, ils ne sont que trois à avoir fait ce choix. Lorsque les beaux-jours arrivent, les autres maisons accueillent à nouveaux leurs propriétaires, des gens de la ville venus se mettre au vert et le plateau sort de sa longue léthargie hivernale. Loin de la civilisation, Mme Doucheyko mène une vie simple et rude, entre promenades en pleine nature, corvées de bois de chauffe, lecture et astrologie, sa grande passion. Aussi curieux que cela puisse paraître, ces conditions de vie plutôt rudes, n’ont guère rapproché les trois ermites du plateau, Mme Doucheyko aurait même plutôt un contentieux avec son voisin le plus proche, qu’elle appelle Grand Pied ; un original du genre taiseux, à l’hygiène douteuse et au caractère irascible. Mme Doucheyko n’aime pas beaucoup ses manières et encore moins ses pratiques de chasse, qui relèvent essentiellement du braconnage. Ce qu’elle aime encore moins c’est le traitement inhumain qu’il réserve à sa propre chienne, qui hurle à la mort d’être enfermée dans un réduit au milieu de ses excréments. Autant dire, que lorsqu’elle est réveillée en pleine nuit par son second voisin pour constater le décès de Grand Pied, Mme Doucheyko n’est pas forcément disposée à prendre en charge les préparatifs de ses obsèques. Mais un détail l’intrigue. Dans sa gorge, elle découvre un petit os, cause probable de son étouffement et de son décès. L’affaire aurait pu en rester là, mais le plateau est subitement le théâtre d’une série de meurtres dont les victimes avaient toutes comme point commun d’être chasseurs. Il n’en fallait pas moins à Mme Doucheyko pour qu’elle élabore une théorie sur la justice du règne animal. La nature serait-elle en train de régler ses comptes envers ceux qui maltraitent les animaux ?
Evitons préalablement tout malentendu, Sur
les ossements des morts n’est pas un polar. L’intrigue n’est
ici qu’un prétexte car le roman est surtout un vibrant hommage à
la nature, une fable écologique et humaniste portée par un
personnage à la fois touchant et inflexible, mais toujours haut en
couleurs. Avec ses petites manies, sa rudesse de surface et sa
manière franche et directe de parler, Mme Doucheyko surprend autant
qu’elle émeut. C’est ce caractère entier, mâtiné d’une
petite touche d’humour noir, qui fait en grande partie la saveur du
roman. Mais ce serait tout de même oublier un peu vite l’ambiance
très réussie du livre, à la fois sombre et oppressante lorsqu’il
décrit les conditions de vie hivernales ou bien encore toutes les
pesanteurs qui régissent les relations sociales dans cette région
un peu reculée du monde. Mme Doucheyko reste une citadine, qui
comprend mal le poids considérable des traditions dans une société
paysanne qui reste encore fortement ancrée dans le passé. Mais
l’auteur sait aussi se montrer plus poétique lorsqu’il s’agit
d’évoquer le caractère un peu plus fantasque de son personnage,
qui se pique d’astrologie à tout bout de champ, passe des soirées
entière à traduire avec l’un de ses rares amis la poésie de
William Blake ou bien encore porte secours au moindre animal en
danger, quitte à se mettre à dos tous les chasseurs de la région.
La grande réussite du roman tient finalement à ce décalage
permanent entre la personnalité entière de Mme Doucheyko et
l’environnement socialement très figé dans lequel elle évolue.
Chacune de ses saillies est donc l’occasion de se délecter de son
étonnante capacité à mettre les pieds dans le plat, avec une force
et une détermination qui n’ont d’égal que sa profonde sincérité
et son courage sans faille.