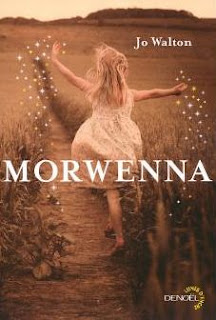Faut-il encore présenter Dune, cette oeuvre phare
de la science-fiction vendue à des millions d’exemplaires depuis
sa parution initiale en 1965 et qui donna lieu à une adaptation
cinématographique réalisée en 1984 par David Lynch (plus ou moins
reniée depuis par le réalisateur), à une mini-série télévisée
(hélas très discutable) et à de multiples jeux vidéo. On passera
rapidement sur le projet avorté d’Alexandro Jodorowsky, qui fut
mis en lumière par le documentaire parfaitement édifiant
Jodorowsky’s Dune, qui eut surtout pour mérite d’illustrer la
folie contagieuse du bonhomme autant que la démesure d’un
projet désormais devenu culte dans les milieux autorisés (trois ans
de préproduction tout de même et 15 millions de dollars de budget partis en
fumée). Depuis, Dune continue de fasciner les lecteurs du monde
entier et les cinéastes, puisqu’une nouvelle adaptation devrait
voir le jour en 2020 sous la houlette du désormais très en vue
Denis Villeneuve. Mais cinquante ans après la parution du premier
tome, que reste-t-il de Dune ? Contrairement à nombre d’oeuvres de
SF qui résistent parfois difficilement aux outrages du temps, le
roman de Frank Herbert peut-il prétendre à autre chose qu’à être
constamment relégué à sa dimension “classique de la
science-fiction” ? Autrement dit, au regard de son influence
considérable sur la culture populaire du XXème siècle, faudra-t-il
un jour publier Dune dans la bibliothèque de la Pléiade ?
Evidemment, je vois déjà les gardiens du temple
monter sur leurs grands chevaux, quel que soit leur bord, les
amoureux du verbe et de la langue travaillée dans le style le plus
pur et le plus classique tomber de leur estrade (ou de leur
piédestal) sous le coup de l’émotion, choqués au plus profond de
leur être, atteints dans leur intégrité morale et intellectuelle.
Mais quelle mouche vous a donc piqué cher monsieur, pour oser
comparer Frank Herbert à Marcel Proust ou bien encore Léon Tolstoï
? Très honnêtement il y a là un brin de provocation, mais
aussi une vraie question sur la notion de chef d’oeuvre et sur
l’intemporalité de certaines oeuvres. Il serait sans doute amusant
de compter les romans ayant obtenu le prix Goncourt (ou quelque autre
prestigieuse récompense) désormais parfaitement oubliés (et ne
parlons pas de leur auteurs). Evidemment, il y a quelque chose
d’injuste dans mes propos, la valeur d’une oeuvre ne se résume
pas au succès populaire ou à ses distinctions, quantité de romans
formidables ne rencontrent jamais le succès et restent oubliés sur
les étagères des bibliothèques. Mais il n’empêche que le succès
populaire de Dune ne semble guère faiblir et son influence
considérable sur la culture populaire de ces cinquante dernières
années interroge. Au-delà de la fable écologique et politique,
l’oeuvre contient incontestablement des éléments qui fascinent
les lecteurs au fil des générations. La puissance de l’univers de
Dune, sa dimension mystique, mais également sa profonde réflexion
sur la religion et le pouvoir en font une oeuvre hors-norme,
quasi philosophique mais aussi profondément ancrée dans le réel.
Cette critique est essentiellement consacrée au premier tome d’un
cycle qui en compte six au total*, mais nous ferons référence
parfois à d’autres éléments clés contenus dans les romans
ultérieurs.
Il est nécessaire d'appréhender Dune comme un
récit initiatique où l’on suit le parcours du héros de son
enfance (ou plutôt adolescence) jusqu’à sa mort supposée. Par
cette approche, Frank Herbert ne fait que s’inscrire dans les
traces des grands mythes, comme le fera plus tard George Lucas dans
Star Wars. Mais là où Lucas se montrait assez naïf et manichéen,
Herbert fait preuve d’un recul et d’une distanciation critique
inédits. C’est ce qui fait la qualité première de Dune et la
base d’une réflexion riche aux ramifications multiples, une oeuvre
dans laquelle les différents romans du cycle dialoguent en
permanence et se répondent dans une histoire qui aime s’inscrire
dans la durée, dans le temps long de Fernand Braudel pourrait-on
dire.
Dune débute par le récit de Paul Atréides, âgé
alors d’une quinzaine d’années. Le jeune homme est l’héritier
du duc Leto, dont la famille occupe la planète Caladan depuis vingt
générations. Mais l’empereur Shadam IV a décidé de confier au
duc le fief d’Arrakis , une planète désertique prénommée
également Dune et connue à travers l’univers pour être la seule
planète productrice de l’épice gériatrique, le fameux mélange.
Une substance très précieuse, qui accroît l’espérance de vie et
étend la conscience. Mais l’épice a également d’autres vertus,
il est indispensable aux navigateurs de la guilde et leur permet de
replier l’espace afin de voyager à travers la galaxie, il est
également au coeur des secrets les mieux gardés du Bene Gesserit,
un ordre matriarcal qui use de ses pouvoirs à des fins politiques et
religieuses. Arrakis est connue pour être une planète
particulièrement inhospitalière, l’eau s’y fait extrêmement
rare et sa surface est balayée par des tempêtes de sable d’une
rare violence. On ne s’y aventure qu’à ses risques et périls
car, en sus de ces conditions climatiques difficiles, le désert
profond est le territoire du ver des sables. Un monstre long de
plusieurs centaines de mètres, d’une puissance extraordinaire et
dont la gueule est constituée de milliers de dents incroyablement
acérées. Leto et ses proches flairent le piège, mais ne peuvent se
soustraire à la volonté de l’empereur, qu’ils soupçonnent de
s’être fait l'allié du baron Vladimir Harkonnen, ennemi juré des
Atréides. La popularité du duc auprès des autres maisons majeures
de cette caste très fermée appelée Landsraad, mais également ses
appuis politiques et la puissance de ses forces armées, ne cessent
d’inquiéter l’empereur, qui ne voit pas d’un bon oeil
l’influence du duc s’étendre, pas plus que les Harkonnen, qui
avaient jusqu’à présent la gestion d’Arrakis et de ses
bénéfices colossaux. Arrivés sur Dune, les Atréides constatent à
quel point leur situation est périlleuse, voire presque désespérée,
mais ils découvrent également l’écosystème étrange et
fascinant de la planète, ainsi que ses habitants, les farouches
Fremen dont ils espèrent se faire des alliés puissants afin de
résister à une offensive des troupes Harkonnen et impériales.
Paul, qui a été élevé par sa mère, dame Jessica, à la manière
Bene Gesserit, fait preuve d’étonnantes dispositions et semble
particulièrement retenir l’attention des Fremen. Serait-il
l’enfant de la prophétie, celui que le peuple Fremen attend depuis
des centaines d’années pour le guider sur la voie sacrée. Sur
Wallach IX, les révérendes mères du Bene Gesserit sont informées
des talents hors norme de Paul, ce qui contrarie leur maître-plan
établi depuis des milliers d’années et qui visait à établir des
croisements génétiques entre les membres les plus prometteurs de la
race humaine, afin d’obtenir l’être suprême, le Kwisatz
Haderach. Mais celui-ci pourrait bien être arrivé plus tôt que
prévu et échapper à leur contrôle.
En surface, le réussite de Dune tient à cet
habile mélange de récit mythique, mâtiné de complots aux
ramifications complexes et d’intrigues politiques de haute volée,
le tout enrobé d’une bonne dose d’un mysticisme étonnamment
digeste car profondément distancié. Doté d’une narration
prenante et d’une atmosphère d’une rare tension, le roman assure
sa part de divertissement et peut parfaitement se lire au premier
degré, mais s’en tenir à ce niveau de lecture serait évidemment
une grave erreur car Dune propose un étonnant éventail de
réflexions qui vont de l’écologie, à la religion, en passant par
le pouvoir et la politique. Frank Herbert semble fasciné par les
mécanismes qui permettent d’influer sur le devenir de l’humanité
sur le long terme. Ces mécanismes ont trait à la religion, en tant
qu’outil de manipulation des masses populaires, autant qu’à
l’exercice du pouvoir. L’idée en soi n’a rien de
révolutionnaire tant religion et politique ont depuis l’aube des
temps entretenu des relations extrêmement étroites, mais elle est
ici au service d’une intrigue qui se déroule sur des milliers
d’années. Dans Dune, le complotisme est élevé au rang d’art à
part entière, des intrigues se cachent dans des intrigues, laissant
entrevoir des plans d’une complexité stupéfiante, à la fois
cruels et élégants. Pour exemple, à son arrivée sur Arrakis Dame
Jessica, qui rappelons-le a été formée dans l’une des meilleurs
écoles de son ordre, constate qu’une mission du Bene Gesserit très
ancienne (la fameuse Missionaria Protectiva) a déjà inoculé au sein de la société Fremen des leviers
religieux d’une grande puissance afin d’asseoir l’autorité de
l’ordre sur la planète et assurer la protection des soeurs. La population locale est donc
particulièrement bien disposée à son égard pourvu qu’elle sache
manipuler les bons curseurs en s’appuyant sur les éléments clés
de la prophétie. Ce sont ces leviers que Jessica manie donc
avec prudence pour assurer sa survie et celle de son fils et ce sont
ces mêmes leviers qui feront de Paul un personnage quasi divin. Les
stratégies politiques sont à l’avenant et rien n’est laissé au
hasard, les plans se calculent longtemps en amont et chaque camp
tente d’avoir plusieurs coups d’avance sur son adversaire avant
d’avancer ses propres pions. Evidemment, ce genre d’exercice a
aussi ses limites et peut parfois faire preuve d’une certaine
suffisance de la part de l’auteur, frappé à l’occasion du
syndrome “oh mon Dieu, regardez comme je suis génial”. Mais
Frank Herbert dispose d’une étonnante faculté à retomber sur ses
pieds, malgré des développements et des logiques parfois un peu
trop poussés dans leurs retranchements. On n’évoquera qu’avec
la plus grande circonspection la question du style, qui me paraît
pour une fois secondaire. Sans être l’indigne galimatias dont on
l’a parfois accusé, Dune ne brille effectivement pas par la
qualité de sa prose, mais cela n’en fait pas pour autant une purge
à lire. Il faut néanmoins reconnaître une certaine lourdeur dans
l’écriture et une tendance au verbiage qui ne manqueront pas
d’irriter certains (moi perso, j’aime bien les joutes verbales).
Mais il faut dire que l’univers est complexe et l’auteur aime,
comme nombre d'écrivains de SF, user parfois de manière immodérée
de nombreux néologismes. Pour ma part, j’estime qu’ils
participent au contraire à la richesse du roman et contribuent à
plonger le lecteur dans cet univers étrange et fascinant.
Frank Herbert saura cependant se renouveler et
changer son fusil d’épaule en terme de construction narrative et
son projet prendra de l’ampleur au fil des romans suivants. La
réussite d’une aussi longue saga ne pouvait reposer uniquement sur
le rôle de Paul et sur son parcours initiatique, les développements
ultérieurs de l’histoire, que l’on retrouvera dans Le messie de
Dune et Les enfants de Dune, prennent littéralement le contrepied de
ce que le lecteur était en mesure d’attendre. Désormais repu de
vengeance, arrivé à la tête de l’imperium, Paul, qui n’a eu de
cesse de lutter contre le destin qui l’attendait et qui dans ses
visions cherche le chemin qui sera le moins sombre pour l’humanité,
doute du bien fondé de son combat. Sa quasi divinité lui fait
horreur et son rôle de monarque absolu, il ne l’assume que pour
mieux éviter à l’humanité de sombrer dans la barbarie. Cette
réflexion sur le pouvoir, avec en toile de fond d’autres
questionnements gigognes (libre-arbitre, altruisme…), est au coeur
de ce qui fait l’essence même de l’oeuvre de Frank Herbert et
n’est pas sans rappeler un certain Machiavel, toutes proportions
gardées bien évidemment.
Livre univers riche et
fascinant, Dune est probablement l’une des oeuvres les plus
complexes de la science-fiction moderne. Mais sa plus grande qualité
c’est son étonnante capacité à parler aux lecteurs de tous les
âges, chacun y trouvant son propre cheminement intérieur et des
résonances personnelles parfois très fortes. Même après une
énième lecture (la quatrième en ce qui me concerne), le roman
révèle des sagesses qui nous avaient initialement échappé et
des niveaux de lecture qui forcent le respect…. à condition de
bien vouloir lâcher prise et se laisser emporter par la puissance de
son flux.
* Dune, Le messie de Dune, Les enfants de Dune, L’empereur-Dieu de Dune, Les hérétiques de
Dune et La maison des mères.