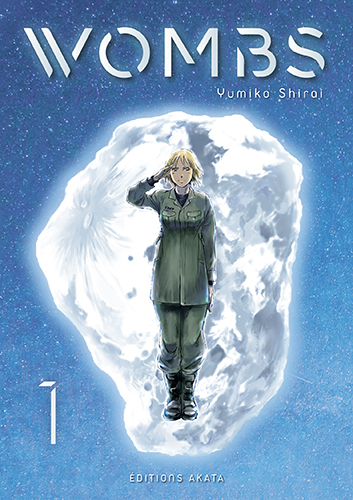Avouez que, comme moi, vous n’auriez pas automatiquement associé culture slave et fantasy. Oh, bien entendu, un certain Andrzej Sapkowski a mis à l’honneur la fantasy polonaise grâce au succès assez phénoménal de The Witcher, mais d’aucun considérait cette réussite comme un épiphénomène. Il faut bien reconnaître que je m’étais indiscutablement fourvoyé, voire, carrément, introduit l’index dans la cavité orbitaire. Non seulement c’est très douloureux, mais en plus c’est beaucoup moins pratique pour lire. Heureusement, le hasard fait parfois bien les choses et en traînant dans les rayons d’une surface culturelle, je tombe sur deux livres de poche à la couverture intrigante, rappelant les codes graphiques du folklore des pays d’Europe centrale. Ce qui n’est pas courant en fantasy, où les couvertures sont souvent inspirées par une heroic fantasy largement influencée par le bestiaire de D&D (ok ok, je schématise). Evidemment, les origines de l’auteure (Naomi Novik est américaine, mais d’origine polonaise et lituanienne) n’y sont sans doute pas étrangères et il faut bien avouer que le mélange a quelque chose d’incroyablement rafraîchissant.
Publié en 2017, Déracinée est un roman d’environ cinq cents pages, dont la qualité première est de se suffire à lui-même. En débutant sa lecture, vous êtes assuré de ne pas vous aventurer dans une énième trilogie de trois mille pages (voire davantage). Ce qui prouve à ceux qui affirment sans cesse que la fantasy a besoin de longues phases d’introduction pour poser les enjeux d’un nouvel univers, qu’il s’agit d’une facilité dont usent ceux qui n’ont en réalité que peu d’imagination en matière de construction narrative. Naomi Novik s’affranchit allègrement de toutes ces ficelles éculées et plonge le lecteur immédiatement dans son univers ; à lui par la suite d’en reconstituer patiemment les enjeux, en récoltant les indices disséminés par l’auteur au fil de son récit. Situé à l’orée d’un bois maléfique, le petit village de Dvernik est soumis à une étonnante tradition. Tous les dix ans, une jeune fille est choisie par le Dragon, un puissant magicien chargé de veiller sur la région et de juguler le pouvoir d’une forêt maléfique. La jeune Agnieszka fait partie des jeunes filles susceptibles d’être choisies, mais cette éventualité ne semble guère la préoccuper car le mage choisit immanquablement le plus jolie et la plus apprêtée des candidates en lice…. et sur ce terrain, Agnieszka n’est pas vraiment la plus à même de l’emporter. Dotée d’un visage sans grâce et d’une gaucherie légendaire, la jeune fille ne s’inquiète guère d’être une hypothétique “heureuse élue”, persuadée que cette place sera dévolue à sa meilleure amie, à la chevelure dorée et au visage angélique. Mais le jour de la cérémonie du choix, rien ne se passe comme prévu et contre toute attente, c’est Agnieszka qui est désignée par le mage. Commence alors pour elle, un long apprentissage pour révéler et développer son don latent pour la magie. Un pouvoir qu’elle ne soupçonnait pas, mais que le Dragon a immédiatement perçu en elle.
La grande originalité du roman, en dehors du fait qu’il s’inspire avec un certain talent du folklore slave/balte, c’est qu’il prend le contre-pied de bon nombre de romans d’apprentissage classiques. Le schéma éculé du Grand Maître plein de sagesse prenant sous son aile paternelle une jeune apprentie au potentiel considérable mais inexploité a vécu. Naomi Novik le bat en brèche dès les premières pages. Rien ne correspond aux patterns habituels. Agnieszka n’est ni jolie ni particulièrement douée (tout du moins dans son apprentissage initial), elle est tête en l’air, désordonnée, maladroite et souvent butée, sa relation avec le Dragon est la plupart du temps conflictuelle en raison de son caractère quelque peu borné. Et pourtant cela fonctionne. Le roman de l’écrivaine américaine prend un malin plaisir à contourner les codes du genre tout en respectant l’essence même de ce qui fait tout le charme de la fantasy : le merveilleux. Avec un ton proche du conte, Naomi Novik nous plonge dans un univers féérique, à la fois familier et étonnant. Certes, on reste en territoire connu, on y croise des magiciens et des sorcières, des animaux fantasmatiques, des reines et des rois…. mais même la magie a quelque chose d’inhabituel. L’auteure oppose ici deux formes de magie, l’une très académique, repose sur des formules complexes nécessitant beaucoup de rigueur et d’entraînement, la seconde, relève davantage du ressenti, de l’instinct et de la pulsion primaire… et c’est celle qu’Agnieszka pratique naturellement, au grand désespoir de son maître. Cette opposition de style est au coeur de la dynamique de la relation entre le Dragon et son élève, elle la complexifie et la rend moins verticale (oserais-je dire moins conservatrice). Le maître apprend ici autant que son élève, chacun se nourrit du savoir et de l’expérience de l’autre, et le moins que l’on puisse dire c’est que dans le domaine de la fantasy cela n’a rien de courant.
Alors certes, tout n’est pas parfait, on n’échappe pas
totalement à quelques clichés et autres personnages stéréotypés,
mais l’ensemble reste très rafraîchissant, original sur de
nombreux points et indiscutablement très prenant. Sincèrement, j’ai
été tellement convaincu par la plume de Naomi Novik, que j’ai
immédiatement enchaîné sur La fileuse d’argent, que je vous
recommande encore plus chaudement et qui plonge bien plus amplement
dans les racines de la culture slave.