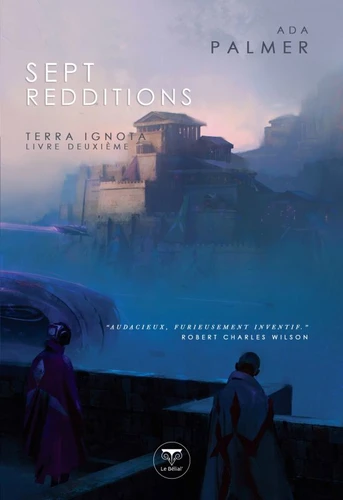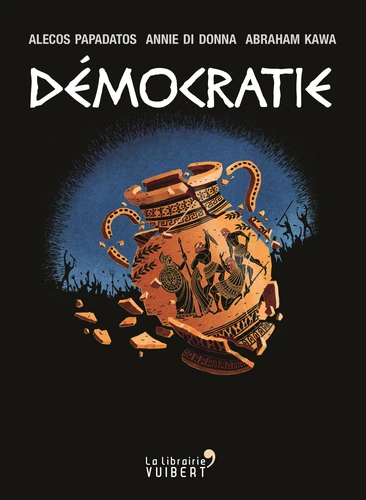Nul ne connaît exactement les origines de Yamamoto Kansuke, l’homme, déjà relativement âgé lorsqu’il entre au service des Takeda, est petit, difforme et borgne, en plus d’être défiguré par la vérole. Mais il est doté d’une grande intelligence, d’une connaissance profonde de l’art de la guerre et d’une assurance apte à déstabiliser ses contradicteurs les plus féroces. Pourtant, lors de sa première entrevue avec le seigneur Takeda, il avoue ingénument, non sans avoir développé un plan d’attaque digne des meilleurs stratèges, n’avoir jamais mené la moindre bataille. Quelques généraux s’indignent alors de l’impudence de cet obscur samouraï sans renommée, mais Shingen Takeda est immédiatement séduit par la personnalité hors-norme de Yamamoto Kansuke et lui confie la charge d’élaborer leur plan d’attaque dans la campagne qu’ils préparent pour s’emparer de la province de Shinano. Grâce aux conseils de son nouveau protégé, Shingen Takeda remporte une victoire rapide et décisive sur son adversaire. Mais en dévoilant son appétit de conquête, le clan Takeda éveille un adversaire encore plus redoutable, Uesugi Kenshin, qui deviendra son rival le plus dangereux dans la région. Années après années, les deux clans se jaugent, mesurent leurs forces dans des escarmouches sans importance, n’osant pas s’affronter véritablement sur le champ de bataille, car une défaite de cette ampleur signifierait alors l’extermination pure et simple de l’ennemi. Les succès militaires du clan Takeda, qu’il doit en grande partie à l’intelligence des stratégies imaginées par Yamamoto Kansuke, assurent à ce dernier une place de choix aux côtés du seigneur Shingen. Un respect mutuel et une profonde amitié lie les deux hommes, mais Yamamoto éprouve également un attachement profond en la personne de dame Yubu, la concubine de son maître, à qui il accorde une fidélité sans faille. Ses efforts mèneront le clan Takeda à la victoire face à Uesugi Kenshin, mais hélas, Yamamoto n’aura pas l’occasion de la célébrer avec son seigneur car il meurt sur le champ de bataille. Persuadé que la tactique qu’il a préconisée a échoué, il se lance dans une charge désespérée contre l’ennemi, sacrifiant sa vie alors même qu’il est l’artisan d’une victoire éclatante.
Figure emblématique de la culture populaire japonaise, Yamamoto Kansuke n’est certes par auréolé du prestige d’un Miyamoto Musachi, mais on peut tout de même leur accorder quelques points communs. Tous deux sont des guerriers d’origine assez modestes, qui doivent leur ascension à leurs talents martiaux, mais alors que Musachi est un bretteur d’exception, Kansuke est surtout un stratège hors pair. Pourtant, ce qui les relie, c’est leur force de caractère assez peu commune et leur rigueur morale. Ils se posent en modèles dans un Japon où la figure du samouraï est sur le point d’évoluer drastiquement. Ils incarnent donc à la fois l’archétype du bushi (guerrier et gentilhomme qui excelle dans la science des armes), mais préfigurent également un nouveau type de Samouraï, qui progressivement abandonne le pur métier des armes (même s’il en garde les symboles les plus évidents, comme la coiffure ou le port des deux sabres) pour devenir un administrateur qui manie davantage la plume que le katana et porte bien plus souvent le kimono que l’armure. Tous deux, bien que marquant une rupture, préfigurent l’image sacralisée du samouraï à travers le code du bushido….. code dont l’origine remonte justement à la geste des Takeda. Le Kōyō gunkan, qui relate les exploits militaires du clan Takeda par le menu, avec force détails sur les forces en présence, les armes utilisées, les stratégies employées... est considéré comme l’embryon de ce qui sera formalisé plus tard sous le terme de bushido (la voie du guerrier). C’est dans l’un de ses volumes que sont narrés les exploits de Yamamoto Kansuke.
A la lumière de ces éléments, on comprend évidemment mieux le rôle capital de ce personnage dans l’histoire du Japon et dans son imaginaire collectif. Tout le talent de Yasushi Inoue réside dans la capacité de l’écrivain à donner une certaine substance à ce personnage légendaire. Ainsi, Kansuke entretient avec l’une des concubines de son seigneur une relation amoureuse purement platonique, qui n’est pas sans rappeler celle de Musachi et Otsü. Un amour contrarié, qui a tous les atours de l’amour courtois, mais qui chez Inoue n’est pas véritablement un moteur du récit, contrairement au roman de Yoshikawa. Il faut davantage y voir un moyen d’explorer les différentes facettes du personnage, une tentative pour le rendre un peu plus humain et ne pas simplement le réduire à sa dimension de génie militaire. Et il faut bien avouer que l’auteur réussit parfaitement à faire de son Yamamoto Kansuke un homme extraordinaire, au sens étymologique du terme, à la fois fascinant, hors-norme et pourtant profondément humain.