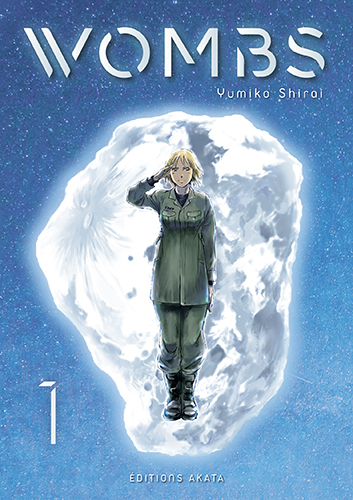C’est en flânant chez mon libraire habituel, que j’ai
découvert fortuitement les romans d’Alison Lurie. Un post-it
enthousiaste habilement apposé sur la couverture, un résumé plutôt
alléchant en quatrième de couv’ et me voilà repartant à la
maison avec un exemplaire de Liaisons étrangères. Trois jours plus
tard, je revenais fébrilement rafler les trois autres romans
disponibles d’Alison Lurie, c’est dire si ma première lecture de
l’auteure américaine m'avait convaincu. Décédée en 2020, Alison
Lurie fut une universitaire de renom, mais une personnalité
discrète, pour autant sa littérature laisse entrevoir des récits
profondément ancrés dans le réel et, probablement, en partie
inspirés par sa propre expérience personnelle. On sent bien
d’ailleurs, au travers de son œuvre, l’évolution assez
significative de ses thématiques (les relations de couple, la
critique acerbe des milieux universitaires et de la classe moyenne
supérieure américaine, le travail d’écrivain et même la
vieillesse et la maladie), qui confère à sa littérature une
profondeur et une hauteur de vue peu communes, ainsi qu’un point de
vue féminin voire discrètement féministe, qui font d’Alison
Lurie une voix singulière des lettres américaines.
N’ayant pas terminé la lecture de ces quatre romans, je vous
propose néanmoins une recension des deux livres que je viens
d’achever, Les amours d’Emily Turner ainsi que Liaisons
étrangères.
“Elle avait vingt-sept ans, et avait toujours, comme au jour de
leur mariage, l’air d’un bel animal élevé et soigné avec
attention, maintenu en permanence au sommet de sa forme pour être
utilisé dans une occasion importante qui ne s’est pas encore
produite et ne se produira peut-être jamais.”
Premier roman d’Alison Lurie, publié en 1962, Les amours
d’Emily Turner, pose déjà les bases des grandes lignes
directrices de l’écrivaine américaine. Sous un aspect assez
policé et une écriture élégante, on y trouve une critique assez
féroce de la classe moyenne américaine, doublée d’une vision
très ironique du monde universitaire, dont on imagine assez aisément
qu’elle ait pu en avoir une perception très complète au cours de
sa carrière de professeur de littérature. On y fait donc la
connaissance d’Emily Stockwell, jeune femme pimpante et énergique,
issue d’un milieu aisé, mariée à Holman, un jeune professeur
assistant, qui vient d’accepter un poste à l’université de
Convers en Nouvelle Angleterre. Emily a tout pour être heureuse, une
situation familiale stable, un mari brillant et séduisant, un petit
garçon auquel elle accorde beaucoup d’attention et un compte en
banque suffisamment garni pour l’éloigner des contingences
bassement matérielles. Oui mais voilà, un matin, alors que Holman,
qui en réalité à tout de l’Américain moyen, s'apprête à
rejoindre son travail, Emily réalise brusquement qu’elle n’aime
plus son mari et que l’homme à qu’elle regarde s’éloigner
depuis le péron de sa maison n’est plus désormais pour elle qu’un
parfait étranger. Subitement, son quotidien, ses relations sociales,
ses activités domestiques ou caritatives… tout lui paraît vain et
factice. Mais davantage encore, c’est ce rôle que la vie lui
impose d’endosser, qui l’épuise et lui fait horeur. C’est
ainsi qu’elle fait connaissance chez une amie de Will Turner,
séduisant professeur de musique aux conquêtes multiples. Emily
tente bien de résister à son charme ravageur, mais l’ennui
qu’elle éprouve chaque jour et le manque d’attention que lui
témoigne son mari, la poussent rapidement dans les bras de Will.
Résolument moderne dans sa manière d’explorer tout un pan de
la société américaine, le roman d’Alison Lurie n’est pas tout
à fait sans rappeler un certain Raymond Carver et sa capacité à
observer couche par couche les grands travers de l’Amérique. Comme
chez Carver, on sent chez son pendant féminin ce déraillement
presque inéluctable du quotidien, cette longue glissade vers une
forme de destruction du cadre traditionnel. L’ennui et le manque de
sens qui marquent notre mode de vie moderne, sont souvent à
l’origine de ce profond dérèglement, tous milieux sociaux
confondus. Quel que soit le bout par lequel les personnages tentent
d’aborder leurs problématiques, notre incapacité à communiquer
voue immanquablement à l’échec toute tentative d’inverser le
processus. Mais le féminisme discret d’Alison Lurie et la
dimension introspective de ses personnages la rapprochent également
d’une certaine Virginia Woolf, avec laquelle elle partage quelques
points communs. Comme chez l’écrivaine anglaise, les personnages
sont mis face à leur destin, ils doivent démêler leurs propres
contradictions et accepter de se libérer de leurs chaînes pour
s’affranchir enfin du carcan de la société moderne. Subtilement,
petite touche par petite touche, Alison Lurie décrit ce microcosme
que représente Convers, qui préfigure tout ce que l’Amérique de
l’époque a de plus classique et normatif. Ce faisant, elle
égratigne l’air de rien le mythe de l’American way of life,
alors même que le monde entier ne rêve à l’époque que d’épouser
ce mode de vie, et pointe les lignes de fracture de la société
américaine. C’est brillant, subtil et parfaitement transgressif
pour l’époque.
Publié en 1984, Liaisons étrangères fut l’un des plus grands
succès critiques d’Alison Lurie et lui valut le prix Pulitzer.
Construit sur un schéma narratif un peu différent, puisqu’il
alterne les points de vue de deux personnages, il met en scène Fred
Turner, un jeune et sémillant universitaire américain, professeur
de littérature classique et Vinnie Miller, également professeur de
littérature issue de la même université, mais spécialiste de
littérature enfantine. Contrairement au séduisant Fred, Vinnie n’a
rien d’une beauté ; âgée d’une cinquantaine d’années,
petite, les hanches étroites et la poitrine menue, Vinnie fait
figure de vieille fille un peu revêche pour qui la vie se résume à
sa carrière professionnelle. Très honnêtement, tous deux
n’ont guère en commun, si ce n’est que leur université leur a
accordé un congé d’étude de six mois à Londres dans le cadre de
leurs recherches respectives. Pour Vinnie, grande admiratrice de
l’Angleterre, ce nouveau voyage en Europe est une bénédiction
attendue de longue date. Celle-ci se réjouit de retrouver un pays au
moeurs moins rustiques, plus policé et bien plus charmant. Quant-à
Fred, il s’imagine déjà arpentant les immenses rayonnages de la
British Library, à la recherche des manuscrits les plus précieux,
parcourant du doigt l’écriture fine et déliée des auteurs du
XVIIème siècle qu’il affectionne tant, visitant les musées et
les monuments de Londres avec avidité sur son temps libre. Hélas
pour nos deux universitaires, la réalité n’a pas grand chose à
voir avec leurs fantasmes ni même avec leurs souvenirs les plus
embellis. Mais c’est surtout pour Fred que le choc est le plus
rude, d’autant plus qu’il avait largement sous-estimé le
budget nécessaire et se voit contraint de se serrer la ceinture la
majeure partie du temps.
Jouant avec humour sur les clichés propres à chaque pays, Alison
Lurie propose un roman à la fois drôle et caustique, qui égratigne
avec beaucoup d’ironie, mais aussi un peu de tendresse, les clichés
largement éculés et les idées reçues sur l’un ou sur l’autre
de ces deux pays cousins, mais pourtant si différents. Une fois
encore, le milieu universitaire et bourgeois est épinglé avec
beaucoup de finesse, de justesse et tout juste ce qu’il faut de
dérision pour ne pas sombrer dans la caricature facile. Sortir du
carcan, abolir les barrières, essayer de comprendre l’autre est
une nouvelle fois au cœur des interrogations d’Alison Lurie, qui,
par son style tout en intelligence et en subtilité, démontre la
grande pertinence de sa démarche.