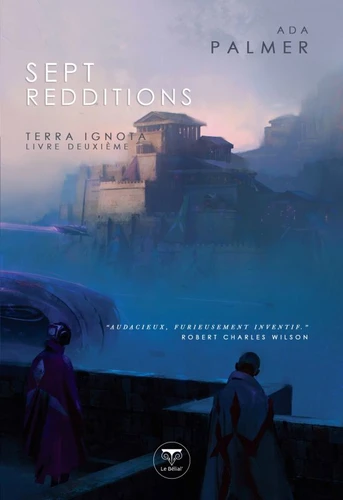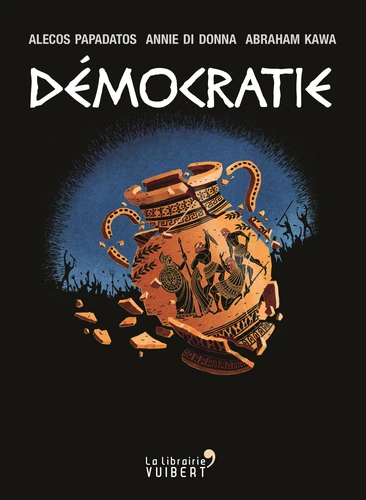De la littérature japonaise, nous connaissons
essentiellement les auteurs classiques du XXème siècle, les
Mishima, Tanizaki, Akutagawa, Inoue, Kawabata et autres grands noms
des lettres nippones. Mais finalement, de la littérature grand
public, celle qui divertit le plus grand nombre et que l’on peut
qualifier de populaire, nous n’avons en France que peu d’échos.
C’est d’autant plus étonnant que la France représente le marché
le plus important pour le manga, juste derrière le Japon, et que
toute une génération de quadras et autres trentenaires a été
biberonnée à l’animation japonaise dès sa plus tendre enfance.
Il est paradoxal que dans un pays où le Japon exerce une fascination
et une influence culturelle si importantes, sa littérature populaire
soit si méconnue. La littérature japonaise garde aujourd’hui
encore, une certaine aura de mystère, une réputation de
sophistication et, ne l’éludons pas, d’inaccessibilité, qui à
mon sens ne lui rendent pas complètement justice. Reconnaissons tout
de même que les éditions Picquier tentent depuis plus de trente ans
de combler le fossé, en proposant à leur catalogue de très
nombreux auteurs contemporains talentueux et populaires dans leur
pays d’origine (toutes proportions gardées évidemment, une
auteure comme Hiromi Kawakami est loin d’atteindre les chiffres de
vente de One Piece). Mais, à toute règle il existe forcément une
ou plusieurs exceptions. Publié sous forme de feuilleton dans la
revue Asahi Shibun entre 1935 et 1939, Musashi, de Eiji Yoshikawa, a
été scindé lors de sa parution française en deux volumes, La
pierre et le sabre et La parfaite lumière. Qualifié d’Autant en
emporte le vent à la japonaise, il s’agit d’un pur roman de cape
et d’épée, qui n’est pas sans rappeler un certain Alexandre
Dumas ; aventure enlevée, narration sans temps mort et personnages
archétypaux… les 1500 pages du roman se boivent comme du petit
lait. Depuis sa traduction, en 1986, le roman a été réédité à
de multiples reprises, signe d’un succès qui ne se dément pas.
Les plus curieux pourront également aller jeter un coup d’oeil sur
l’adaptation du roman sous forme de manga, Le vagabond, qui ne
démérite pas le moins du monde, mais qui paraît tout de même un
peu fade après avoir pris goût au style d’Eiji Yoshikawa.
Personnage historique éminemment populaire au
Japon, Miyamoto Musashi vécut au XVIIème siècle. Maître bushi,
peintre, calligraphe et même philosophe, il construisit sa renommée
sur ses talents de bretteur d’exception, au point de devenir le
maître de sabre le plus réputé de son temps. Outre ses aptitudes
remarquables pour le combat, l’immense prestige de Miyamoto Musashi
tient au fait qu’il fut certainement l’une des dernières
grandes figures guerrières de cette période. Prestige
d’autant plus grand qu’il participa à la mythique bataille de
Sekigahara (du côté des vaincus), dont le vainqueur fut le célèbre
Ieyasu Tokugawa, qui termina la grande entreprise de réunification
de Japon entamée par Oda Nobunaga et Hideysoshi Toyotomi, devenant
ainsi le fondateur d’une longue dynastie de shoguns. Après plus
d’un siècle de guerres incessantes et fratricides, le Japon connut
alors une période de paix d’environ deux siècles et demi. Durant
l’époque Edo, les combats au sabre furent interdits et le pouvoir
des Daimyos (seigneurs de guerre) fut habilement jugulé. Dans un
pays désormais pacifié, des cohortes de samouraïs se retrouvèrent
sans emploi, devenant rônins pour une grande partie d’entre-eux.
Les compétences guerrières devinrent ainsi progressivement des arts
martiaux, répondant à une philosophie du bushido poussée à son
paroxysme, mais désormais bien éloignée du champ de bataille.
De brutes sanguinaires à la lame facile, nombre de samouraïs
devinrent des maîtres de la cérémonie du thé, d’excellent
calligraphes et de fins lettrés... ou des brigands sans foi ni loi
pour les rônins que la pauvreté et la misère guettaient. Dans ce
contexte, il n’est guère étonnant que Miyamoto Musashi fut dressé
en figure archétypale du samouraï, guerrier invincible et parangon
de vertu, car la Pax Tokugawa fut aussi une période d’essor pour
le divertissement et en particulier pour le théâtre kabuki, qui
narrait les talents des plus grandes figures guerrières du Japon.
Les exploits singuliers de Miyamoto Musachi furent donc repris,
amplifiés et évidemment déformés par les conteurs itinérants,
pour le plus grand plaisir des Japonais.
Eiji Yoshikawa ne fait que reprendre à son compte
cette tradition théâtrale et romance avec un certain talent la vie
du grand guerrier. Son récit commence juste après la bataille de
Sekigahara, alors que Musachi (qui se nomme alors Takezo Shinmen),
blessé, gît sur le champ de bataille. En recouvrant ses esprits, il
constate que son ami d’enfance, Matahachi, a lui aussi échappé au
massacre. Ensemble, ils tentent de regagner leur petit village de
Miyamoto, où Otsü, la fiancée de Matahachi, se fait en sang
d’encre. En chemin, ils tombent sur la petite masure d’Oko et de
sa fille, la jeune Akemi. Mais au bout de quelques jours, alors que
leurs blessures sont guéries, Matahachi refuse de retourner au
village et s’enfuit avec la séduisante Oko. De retour à Miyamoto,
Takezo doit faire face à la vindicte de la mère de Matahachi, qui
l’accuse de tous les maux et jure d’avoir sa tête. C’est
finalement grâce à l’aide d’un moine, Takuan, et de Otsü,
qu’il parvient à échapper à un lynchage en règle. Commence
alors une longue errance à travers le Japon, une fuite autant qu’une
recherche de la voie du sabre. Ceux qui l’aiment comme ceux qui le
détestent sont à sa poursuite, alors que lui tente de se faire un
nom à travers la maîtrise des armes. Il y a dans l’aventure de
Musachi, quelque chose de rocambolesque et d’infiniment romanesque,
ce puissant rônin poursuivi par une petite vieille acariâtre qui a
juré de lui faire la peau, ainsi que par une jeune fille tombée
éperdument amoureuse et un petit garçon qui ne cesse de vouloir
devenir son apprenti, est évidemment un ressort puissamment comique.
Le ton du roman, que l’on aurait pu croire plus grave, est donné.
Yoshikawa manie le burlesque et l’assume parfaitement. Ce qui
n’empêche pas l’auteur, de s’éloigner assez régulièrement
de la farce, dans un registre plus intime, voire parfois même très
poétique, notamment lors de la rencontre de Musashi avec la célèbre
geisha Yoshino (sans aucun doute l’un des chapitres les plus
subtils du roman). Le reste de l’histoire relève de l’aventure
débridée, avec moult poursuites et scènes de combat. Le ton du
roman d’Eiji Yoshikawa contraste cependant avec l’image de
Miyamoto Musachi qui nous est parvenue jusqu’en Occident. La
légende laissait augurer un maître bushi dans toute sa splendeur, à
la fois posé et plein de sagesse, n’usant de son arme qu’en cas
d’absolue nécessité. Un sensei entouré de disciples avides
d’acquérir les arcanes les plus subtiles de l’art du sabre, tout
aussi enclin à savourer un thé en regardant les cerisiers en fleurs
qu’à faire une démonstration de sa maîtrise technique. Mais le
premier tome étant consacré à la jeunesse de Musachi, Eiji
Yoshikawa décrit plutôt un jeune homme impulsif, prêt à en
découdre pour prouver sa valeur et à bousculer les convenances. Pas
toujours sympathique et progressivement conscient de ses
imperfections, Musachi cherche cependant la voie. Quête sans fin
dont on se demande désespérément s’il comprendra un jour
qu’elle n’est pas tant dans le maniement du sabre que dans le
développement de ses aptitudes morales et spirituelles. Les
vicissitudes de la vie se chargeront néanmoins de lui mettre un peu
de plomb dans la cervelle. Se dessinent alors les contours d’un
homme plus sage, plus responsable, mais aussi et surtout un peu plus
subtil. Yoshikawa reste cependant suffisamment subtil pour ne pas en
faire des tonnes et sans nous assommer d’une mystique à trois
francs six sous, si chère à certains auteurs.
Enlevé, incroyablement dynamique, le récit ne
souffre aucun temps mort, multiplie les personnages, qui se croisent
et s’entrecroisent dans un ballet incessant, jouant constamment
avec le lecteur. Formellement, le récit est une grande réussite,
grâce à une technique narrative qui doit tout à sa forme
épisodique et qui use plutôt habilement des cliffhangers. Mais
c’est aussi une des limites de l’écriture de Yoshikawa, dont on
perçoit assez facilement les ficelles lorsqu’on lit le roman d’une
traite (ce qui n’était pas le cas lors de sa parution par épisodes
dans les années trente). Certains pourront également trouver les
personnages quelque peu stéréotypés (la bêtise crasse de
Matahachi, la méchanceté gratuite d’Osugi, la brutalité de
Musachi ou bien encore la fragilité agaçante d’Otsü), mais c’est
un peu la règle du jeu dans ce type de littérature, il faut s’en
amuser plus que s’en agacer car cela fait partie du comique de
répétition qu’emploie allègrement Yoshikawa. D’autant plus que
l’auteur arrive régulièrement à dépasser cette caractérisation
simpliste et à donner un peu de profondeur aux scènes clés.