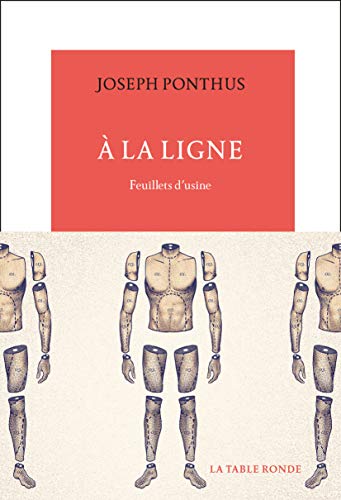Cher Emmanuel,
Il y a bien longtemps maintenant, tu as éclairé le chemin vers des contrées où je n’aurai jamais jeté qu’un regard distrait sans le secours de ton érudition. Certes, je n’étais pas une ignorante totale, mais à peine une novice sans autre souci que de rapiécer une culture lacunaire et de satisfaire à peu d’efforts un goût pour les voyages immobiles qui s’accomplissent avec le lent mouvement des pages tournées.
Bien sûr j’avais déjà visité quelques cités obscures esquissées par un dessinateur de talent assisté d’un architecte à l’imagination romantique, où les personnages dépassés se confrontaient à des urbanismes oniriques. Bien sûr j’avais déjà voyagé dans le temps, parfois fort loin, en compagnie de robots qui rêvaient. Bien sûr, j’avais déjà, entre terre et mer, découvert quelques créatures écailleuses et sages… Mais ce n’étaient là que petits sauts de puce par rapport aux autres voyages dans le temps, ceux-là dans notre passé, qui m’emportaient bien plus souvent, beaucoup moins dans l’imaginaire des hommes que dans leurs déraisons profondes et la singularité des destins échus.
Et puis voilà donc notre rencontre, par des aléas administratifs tortueux et implacables, qui menaient les gens du sud radieux vers le nord grisâtre et les habitants des vallées royales vers les terres ravagées par la guerre.
Et vint une rouge servante, et au fil des années tant d’autres compagnes et compagnons de papier que j’ai oubliés. Nous avons partagé nos lectures comme d’autres s’attablent autour d’une bonne chair arrosée du nectar de la vigne, pour échanger nos impressions sur des catastrophes nucléaires, des mondes étranges, de misérables destins ou de goûteux crayonnages, de longs classiques mémorables ou de courts et secs récits et des terres fertiles où poussent des idoles de pierre dans des jardins clos.
De lecteurs peu convaincus en découvreurs plus enthousiastes, une lecture qui en appelle une autre, encore une autre. A force de suivre les recommandations du plus aiguisé des chroniqueurs littéraires, et de ses affidés, même anonymes, surtout anonymes, on glisse sur la pente fatale qui vous mène aux acquisitions de petits délires livresques, où un écrivain se mue en explorateur d’un monde merveilleux dans lequel s’entrechoquent les vestiges de deux conceptions du rêve humain, capturées dans les images d’un dessinateur émerveillé épris du souci de nous restituer toute l’atmosphère aux limites du sensé de cette quête sans but tangible. De cet album, on se demande par quel miracle il m’est parvenu, quel chemin improbable il a suivi pour venir s’ouvrir entre mes mains, et qui semble s’adresser à moi non en tant que lectrice mais en tant que confidente. Car c’est presque une histoire personnelle entre chaque lecteur et chaque exemplaire de ce récit qui s’épanouit dès l’ouverture de l’ouvrage.
Tout à coup un doute surgit : peut-être suis-je tout simplement en train de détruire un peu de l’enchantement qui s’empare peu à peu de la lectrice attentive en tentant de le transmettre, comme ces particules quantiques qui s’évanouissent aussitôt qu’observées, ou plus encore dans ce monde statuaire, comme ces furtifs qui se figent aussitôt qu’aperçus. Mais si seulement l’un ou l’une d’entre celles qui lisent ces lignes pouvait, ne serait-ce qu’apercevoir entre mes mots si maladroits, l’ombre de l’esquisse du bonheur qui m’a emporté sur les chemins ouverts par cette correspondance entre l’explorateur et moi, alors tous ces détours n’auront pas été vains…
Mais
n’est pas Jacques la première écrivaillonne venue, et quant à
François, la simple idée que j’esquisse un croquis pour rendre
compte de son talent est déjà une insulte à son art. Aussi, cher
Emmanuel, après ce long détour nostalgique et ce pastiche si
gauche, je te prie de croire sur parole que Les Mers
perdues méritent le temps de sa lecture, et que celle-ci te
transportera une nouvelle fois, sans faillir, dans un espace et un
temps indéterminé, du côté des rêveurs de monde.
Ton affectionnée lectrice, Valérie
Post-scriptum : la Toile est un incomparable espace, et voilà un éclairage sur cette œuvre singulière.