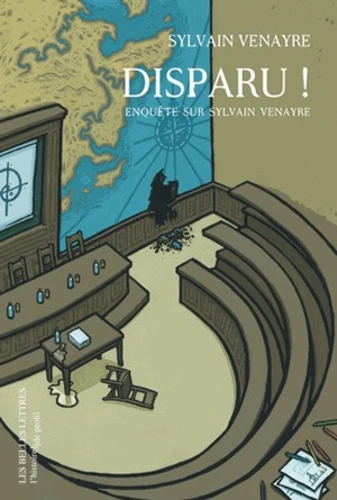Deuxième ville de France, et pourtant grande absente du paysage médiatique français (sauf lorsqu’il s’agit de parler de foot, de feu Bernard tapie ou des fusillades dans les quartiers nord), Marseille cumule les paradoxes. Son histoire, sa géographie ou bien encore sa culture, devraient en faire un pôle d’attraction plutôt qu’un repoussoir…. et pourtant, l’image de la ville n’a rien de très glamour. On la trouve trop “cosmopolite” (savourez l’euphémisme), trop sale, trop populaire, trop violente, mais au fond, les Français la connaissent mal et préfèrent en cultiver une image éculée et stéréotypée (rap, soupe au pistou et vols à la tire). Loin de moi l’idée de balayer d’un revers de la main le taux de criminalité plutôt élevé de la ville (lié davantage à sa taille critique et à sa démographie, plutôt qu’à une véritable culture de la violence) ou bien encore la décrépitude de certains quartiers laissés à l’abandon, mais nier la vitalité et la richesse culturelle de cette ville est lui faire une grande injustice. Encore faut-il percevoir, au-delà des apparences, cette dimension essentielle et profondément humaine. La littérature peut nous y aider, modestement, et ouvrir une fenêtre sur la cité phocéenne, mais cette vérité restera forcément parcellaire. Qu’importe, elle est une pièce de cette immense mosaïque que représente Marseille. Parmi les auteurs phares de la ville, Jean-Claude Izzo fait figure d’incontournable, il est l’un des premiers à avoir saisi le potentiel de Marseille en matière de polar. Ce mélange de culture urbaine, de gouaille marseillaise mâtinée de traditions populaires et provençales a quelque chose d’unique…. à condition de ne pas sombrer dans le cliché et la facilité. Ce qui est moins facile à dire qu’à faire.
Chourmo est le second volet de la trilogie marseillaise et je ne saurais trop vous conseiller de commencer par Total Khéops (lu il y a une bonne vingtaine d’années si mes souvenirs sont bons), qui permet de faire connaissance avec Fabio Montale, le flic au grand coeur mais écorché par la vie, qui se raccroche à un passé qui ne cesse de partir en lambeaux, alors que les cadavres s’accumulent autour de lui, reliefs d’une vie de chaos (d’où l’expression, total Khéops, reprise au groupe IAM). Fabio, un vrai personnage celui-là. Viscéralement attaché à sa ville et à sa culture, mais en total décalage avec une cité en pleine évolution, qui se fiche bien de ses anciens amours. L’homme a quitté la police et vit une existence de père tranquille, du côté des Goudes (un quartier qui a tout d’un petit village de pêcheur, avec ses cabanons regroupés autour d’une crique, à quelques encablures des calanques), une vie oisive où la pêche et les apéros-pastis avec les copains du quartier tiennent une place prépondérante, mais d’où suinte pourtant un certain ennui. Mais la vie va se charger rapidement de le rattraper en la personne de sa cousine, dont le fils a mystérieusement disparu alors qu’il devait retrouver sa petite amie dans le quartier du Panier. Fabio reprend donc du service et remonte la piste de l’adolescent fugueur, dont il retrouve hélas rapidement le cadavre. Débute alors une enquête difficile pour retrouver la petite amie de Guitou et reconstituer la chronologie des événements afin de retrouver le tueur. Mais Montale n’est pas né de la dernière pluie et sent bien que derrière ce meurtre, se cache sans doute la petite arrière-cuisine pas très propre de la pègre marseillaise. Reste à comprendre comment Guitou s’est retrouvé mêlé à cette affaire, lui, l’ado au regard si doux qui rêvait d’amour.
Chourmo n’est,
il faut bien le reconnaître, sans doute pas le roman le plus à même
de redorer l’image de la cité phocéenne. L’histoire est sombre,
tragique, désespérée et Montale, malgré son capital sympathie
n’est pas exactement un personnage solaire. Le début du roman est
même, à mon sens, un brin caricatural, mais il a le mérite de
poser une ambiance, de lui donner une tonalité et un relief bien
particuliers. J.C. Izzo réussit à insuffler une certaine
authenticité à son récit, en dépit de quelques clichés un peu
faciles on se laisse porter par l’atmosphère de la ville ; les
locaux et les amoureux de Marseille retrouveront leurs marques. Les
noms des rues et des quartiers évoquent immanquablement des images,
des odeurs, des sensations quasiment épidermiques et l’on rêve
évidemment de se retrouver assis à la terrasse d’un minuscule
café des Goudes, à regarder la mer faire des clapotis contre le
quai du petit port. C’est sûr, ça fait davantage rêver que les
barres de béton décrépi des quartiers nord ou les petites ruelles
sales et un peu glauques qui descendent de la gare Saint Charles vers
le vieux port. Et pourtant, Marseille c’est tout cela à la fois.
Oui, c’est la soupe au pistou et l’anchoïade, les ruelles
sordides et les boulevards splendides, le soleil éclatant et les
bourrasques infernales du mistral, c’est cette vue magnifique que
l’on peut contempler tout son saoul depuis la Bonne Mère ou bien
encore ces joueurs de pétanque aux répliques dignes d’un roman de
Pagnol… Marseille c’est cette cité incroyablement vivante et
bigarrée, dont on sent à chaque instant battre les pulsations et
dont on perçoit toute l’énergie et la souffrance. Lire Izzo,
c’est un peu toucher du doigt cette réalité et la faire sienne
afin de mieux comprendre ce qu’est être “marseillais”.